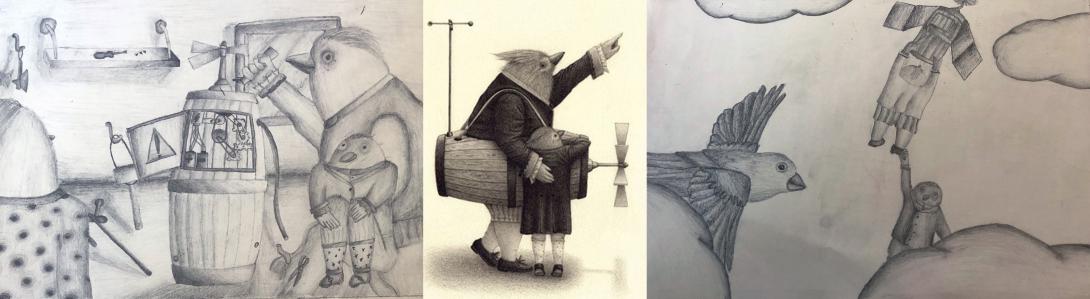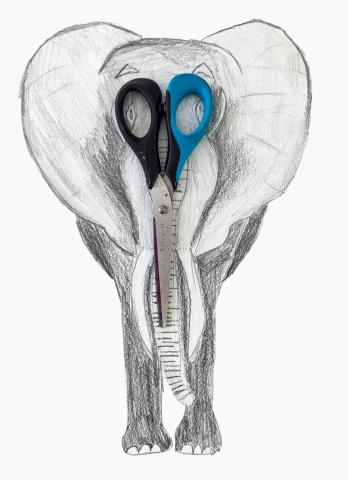Dès le milieu des années 90, Henri Moser critique en effet les sept périodes de 45 min, l'ingurgitation des connaissances sans réelle appropriation, les emplois du temps générés par ordinateur en fonction des disponibilités des professeurs tout en promouvant l'informatique, la vidéo, les CD-Roms...
Les fondamentaux de la réforme formulés en 2000
- les 7 périodes quotidiennes de 45 min sont remplacées par 4 exposés de 20 min chacun
- chaque exposé est suivi par une séance de travail pluridisciplinaire, en groupes, de 60 à 90 min
- les enseignant-e-s deviennent spécialistes d’une fonction : responsables des exposés, des protocoles de travail, des travaux de laboratoire, du centre de documentation, de la correction, de l’évaluation, des conseils pédagogiques, etc.
- chaque enseignant-e est le tuteur-trice d’un groupe d’élèves durant les 6 semestres du secondaire II
- le plurilinguisme remplace le bilinguisme
- la nouvelle école est pensée en fonction : 2 auditoires, en contact direct avec les espaces destinés aux travaux de groupe, sont inscrits au cahier des charges, comme les salles de réunion à disposition des enseignant-e-s.
« Changer ne m’intéresse pas. Faire mieux, là, oui ! »
Henri Moser
A la pointe de l’innovation, en adéquation avec son temps
Fondée sur le travail de groupe, son approche privilégie la collaboration et l’échange. Cette participation active des élèves stimule la confrontation des idées, pousse à chercher l’adhésion pour mieux appréhender et asseoir son savoir : rien n’est mieux assimilé par un-e élève que lorsque l’un-e ou plusieurs de ses camarades le contestent, le reprennent, le corrigent. Cette pratique enrichit les membres du groupe tout en consolidant le savoir de chacun d’entre eux.
Interview d'Henri Moser, fondateur de l'Ecole, 2019
Si les mérites personnels se traduisent toujours par des évaluations individuelles lors des semestrielles ou examens de maturité, les compétences académiques de recherche, de réflexion critique, d’analyse, de résolution de problèmes, de collaboration, de prise de conscience des forces et faiblesses, tout autant que les compétences sociales, se voient profondément renforcées.
Evolution du rôle des enseignant-e-s
Partant, la place et le rôle du corps enseignant évoluent dans la classe. Le « bon enseignant » d’Henri Moser n’est plus l’unique détenteur-trice d’un savoir destiné à être approprié à la virgule près mais le ou la collègue d’un ensemble qui collabore, échange, accepte les regards critiques. Ainsi, les évaluations, questions et problèmes soumis aux élèves sont discutés en commun, de même que les critères de correction et le barème des semestrielles ; dans certaines disciplines, la gestion du groupe d’élèves est partagée entre plusieurs enseignant-e-s.
Visionnaire, cette réforme a préparé l’introduction progressive des outils numériques dans les classes en développant les compétences sociales qui contribuent à leur utilisation réfléchie, pertinente et équilibrée.
Affinée depuis son instauration, adaptée, en partie, au primaire et au secondaire I, la réforme vise à donner confiance à nos élèves dans leurs capacités et dans leur esprit d’initiative afin de trouver leur place dans une société de plus en plus compétitive et versatile.